| |

"LA
FILIERE REICHSHOFFEN"

De nos jours, le sujet "filière Reichshoffen"
fait penser à des trafiquants de drogue ...
mais durant la période de la seconde guerre mondiale
c’était la filière des passeurs de
prisonniers évadés. Comme des trafiquants de drogue,
ils avaient le droit de mentir,
le droit de faire de faux papiers, le droit de faire un
commerce illégal, le droit d'amadouer
autrui, le droit de jouer la comédie ... de faire tout
ce qui était illégal aux yeux de
l'occupant allemand, mais il ne fallait surtout pas se
laisser prendre la main dans le sac !
Ils ne se bagarraient pas avec des armes tels que les
FFI, mais avec l'intelligence et le coeur
pour organiser l'évacuation des prisonniers de guerre
évadés et d'autres personnes
menacées par le régime hitlérien !
Il existe un témoignage très intéressant d’un
certain Lucien Fischer d’Abreschviller, ce
dernier mentionne l’existence d’une importante
filière à Reichshoffen dirigé par
Paul Rudloff.

Paul Rudloff dans son atelier de
peinture à Reichshoffen (5 Rue des Baigneurs, actuelle
résidence du Gîte de la Renardière), les cachettes
secrètes ont été conservées dans la maison.

L'ancienne Maison Rudloff à côté de l'ancien Moulin.

Dans les combles, au-dessus de la nef
de l'église catholique de Reichshoffen, une cachette
servait aux évadés.

RUDLOFF
- ROSIO ET D'AUTRES ...

Lucien Fischer d'Abreschviller dit : «
On ne savait rien de la filière de Reichshoffen.
Des évadés arrivaient, souvent guidés par des jeunes
filles.
On ne savait pas d’où ils venaient. Mais un jour,
on s’est trouvé dans la filière de
Reichshoffen et on n’a su comment qu’après la
guerre.
Beaucoup d’évadés qui venaient de Reichshoffen
passaient par Lorquin où Emile Rosio,
originaire de Reichshoffen, était comptable à la
Scierie Robein.
Il savait que nous faisions passer la frontière.
Quand il a voulu arrêter parce qu’il se sentait
surveillé, il a dit à ceux de Reichshoffen :
“Envoyez les évadés au Rehthal, chez Fischer,
parce que moi, je ne peux plus”.
Et c’est comme ça qu’ils sont arrivés chez
nous. »
(Emile Rosio sera interné à Schirmeck le
15 mars 1943 et libéré le 27 juillet 1944).
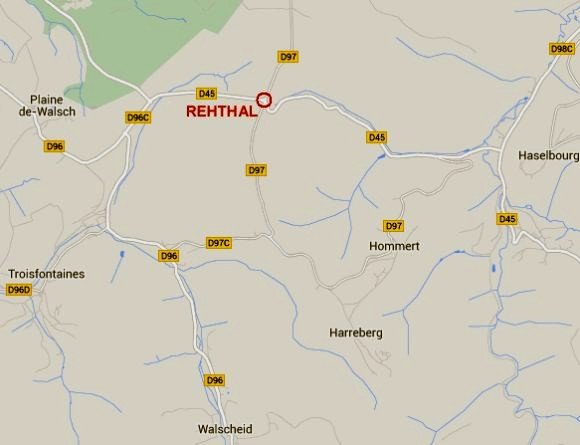
Le Rehthal est petit hameau localisé
sur un carrefour routier en Moselle entre Haselbourg et
Plaine-de-Walsch.

Le Rehthal en Moselle, un hameau de
quelques maisons.
L'organisation Rudloff de Reichshoffen trouva dans la
famille Fischer, père et fils voituriers,
une aide précieuse. Connaissant parfaitement les
forêts, ils amenèrent les évadés depuis la
gare d'Arzviller jusqu'au hameau de
Saint-Léon-Walscheid, où d'autres passeurs les
conduisirent jusqu'à Cirez-Badonviller, non loin de la
frontière franco-allemande.

MERTZWILLER


Le Restaurant de la Zinsel à Mertzwiller
(famille Feuerer).
A Mertzviller, Cécile Feuerer, épouse Klipfel, tenait
le Restaurant de la Zinsel.
Elle venait jusqu’à Arzviller par le train avec
parfois dix ou quinze évadés.
Ça ne se voyait pas trop parce qu'à cette époque, pour
se déplacer, il n’y avait que le train.
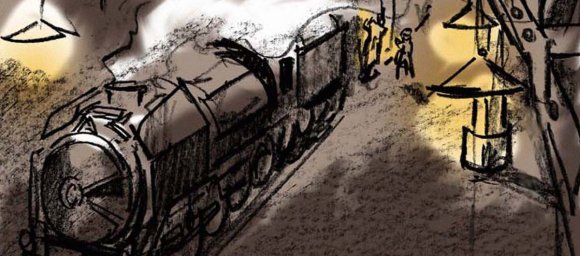
Départ en train des évadés.
Mais, pour avoir des billets, il fallait être bien avec
le chef de gare. Les évadés faisaient
semblant de lire des journaux allemands pour passer
inaperçus, eux qui ne savaient
généralement pas l’allemand !
Elle descendait la première : si elle descendait, les
évadés descendaient aussi.
Ceux de Reichshoffen connaissaient sa filière, mais
chacun travaillait à part.
Alors, ces évadés arrivaient séparément.
Le père de Lucien Fischer disait : “Pourquoi vous
ne venez pas tous ensemble ?”
Nous, on leur donnait un coup de main, c’est tout.
Un jour, on est allé à Sarrebourg pour
chercher des vêtements civils pour un évadé qui y
avait de la famille.
Ils ont demandé où il était, mais on n’a rien
voulu dire.
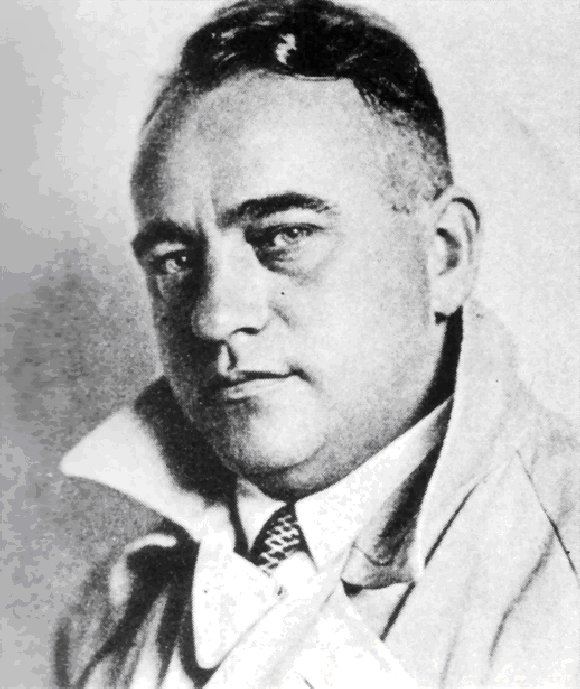
Gauleiter BURKEL
En Avril 1941, le Gauleiter Burkel a imposé en Moselle
le Service du Travail Obligatoire.
Après une visite médicale à 18 ans, il fallait aller
à l’Arbeitsdienst, puis, à partir d’Août
1942,
il fallait aller au service militaire. Chaque fois que
Lucien Fischer allait passer le Conseil de
Révision, sa mère apportait au médecin du lard, du
beurre, des saucisses et il était ajourné.
Mais quand le grand professeur venait, on le cachait.

DE
DIETRICH

C’est en 1942 que la filière a le mieux marché.
Les évadés des stalags (camps de prisonniers soldats)
d’Allemagne étaient rassemblés à
Reichshoffen.
A partir de 1942, il y a eu aussi des jeunes qui
refusaient de servir dans l’armée allemande,
ou qui avaient été incorporés et profitaient
d’une permission pour s’évader vers la France.
A Reichshoffen, Paul Rudloff avait organisé
l’accueil des évadés.
Tous les habitants de Reichshoffen participaient
d’une façon ou d’une autre.
L’usine De Dietrich, de Niederbronn, donnait de
l’argent pour les habiller en civil ou
teindre leurs vêtements. Et aussi pour les nourrir.
L’usine de chaussures donnait des chaussures sans
ticket, mais il était entendu que si les
évadés étaient repris, ils devaient dire qu’ils
les avaient volés.
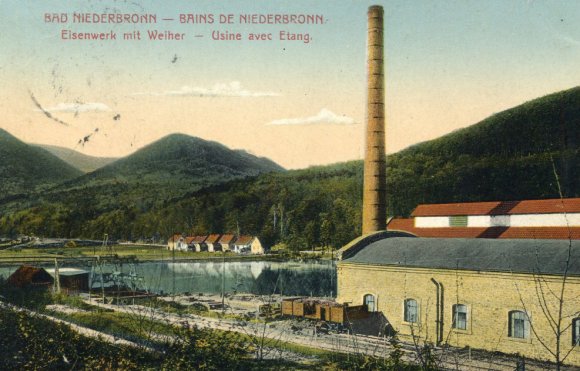
L'usine De Dietrich de Niederbronn
finançait l'action des passeurs.
Une fois habillés et nourris, les évadés prenaient le
train jusqu’à Arzviller.
Par Guntzviller, ils montaient au Rehthal en traversant
la forêt.
Ils avaient des boussoles (de fortune) fabriquées dans
les camps et ils savaient où ils
devaient aller.

Kit de boussole de fortune

Montage de la boussole
Les enfants les voyaient et en parlaient à l’école
; alors, l’instituteur disait qu’il ne fallait
pas parler de ça.
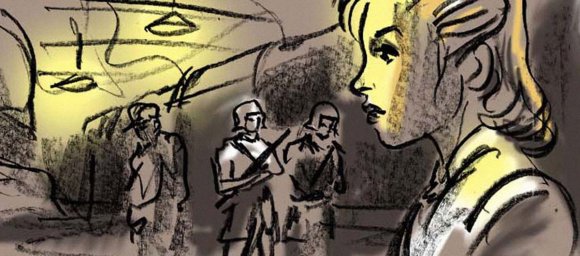
L'accompagnatrice descendait en premier
du train.

LES
FILLES A VELO

Des jeunes filles allaient à vélo sur les routes, et
quand elles voyaient des évadés, elles
laissaient tomber des petits paquets avec de la
nourriture : du pain, du lard, de la saucisse.

Les filles à vélo laissaient tomber des
paquets de nourriture.
Ils arrivaient au Rehthal généralement la nuit et
allaient directement au fenil, et quand le
père de Lucien Fischer allait nourrir les chevaux, le
matin, il les trouvait.
Il rentrait alors à la cuisine et disait à sa femme :
”Fais une grosse casserole de café !”

Il fallait nourrir les rescapés avec
du pain, du lard, de la saucisse ...

ARRESTATION

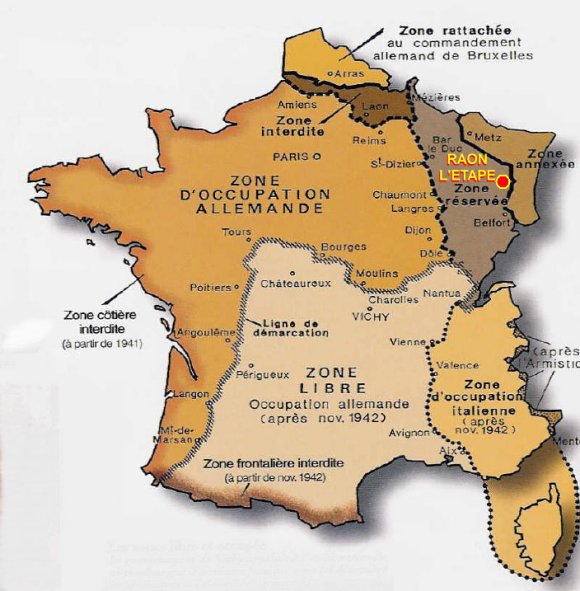
Destination, sortir de la zone annexée.
… Les évadés allaient ensuite à Luvigny ou à
Raon-sur-Plaine :
ils étaient en France. A Raon-l’Etape, la famille
Mathieu fournissait des papiers pour passer
la ligne de démarcation.
Combien on en a fait passer ? Dans les journaux on
avançait un chiffre :”Plus de 3.000 !”
Lucien Fischer dit : Je ne pense pas. Si on en a fait
passer 1.000 jusqu’en 43, c’est le
maximum.
Une fois, en une semaine, on en a eu 82 !
Tous les gens du Rehthal nous aidaient à les nourrir,
ils donnaient du pain, de la saucisse,
du lait, du vin, ...mais personne ne voulait
d’évadés chez eux.
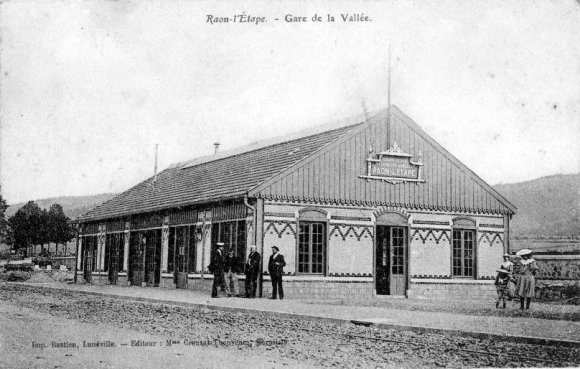
Le petit train de la vallée de RAON l'ETAPE
a survécu aux deux guerres mondiales et transportés
selon les époques entre 100 000 et 200 000 voyageurs par
an.
Sur une longueur de ligne de 23 Km avec 13 arrêts fixes
ou facultatifs en 1H10.
Dans les périodes tragiques des guerres et
d’occupation, il est présent en transportant des
troupes
et blessés tout en continuant son service, il est un
maillon dans la filière des passeurs convoyant
évadés, fugitifs puis clandestins puis assure le
ravitaillement du maquis constitué.
… Quand ces évadés arrivaient chez eux, ils ne
pouvaient pas se montrer sous peine d’être
arrêtés. Alors, ils rejoignaient De Gaulle ou les
maquis de la Résistance. A notre procès en
juillet 1944, le juge a dit que "la route du Rehthal
avait donné un régiment aux Alliés
contre l’Allemagne".
… Ceux de Reichshoffen avaient été pris, mais nous
ne le savions pas.
C’est pour cela que nous avons été arrêtés, ils
ont dit que les évadés allaient chez nous.
Léon Ramm aussi a été arrêté, avec des prisonniers,
et il a été emmené à Metz.
Lucien Fischer :
… Les gestapos voulaient me faire dire que je
connaissais ceux de Reichshoffen et je ne
savais pas qu’ils avaient été pris. Ils m’ont
fait jurer que je ne connaissais pas ceux de
Reichshoffen. J’ai toujours prétendu à la gestapo
que j’étais innocent :
j’ai juré et je leur ai dit : ”Si vous me
fusillez, vous fusillez un innocent !”.
Au bout de deux semaines, ils m’ont dit : “ On
va vous envoyer à Schirmeck et on va vous
présenter ceux de Reichshoffen”. Je suis arrivé à
Schirmeck à la fin mars, avec deux SS
qui avaient ordre de me mettre dans une cellule isolée.
Mais les SS étaient fatigués et ils m’ont jeté
dans une baraque, pour aller plus vite.
Quand le commandant Karl Buck a su cela, il a voulu
fusiller les deux SS.
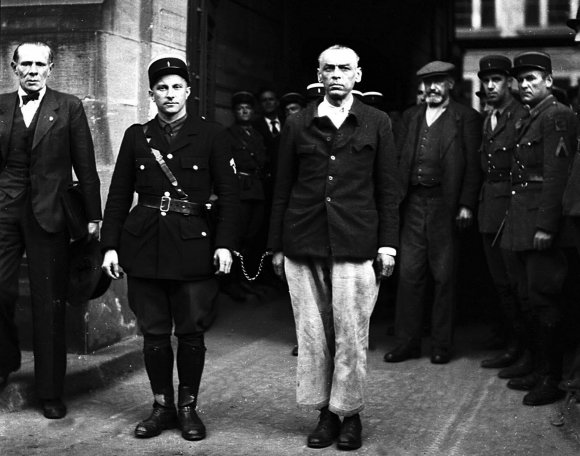
Karl Buck, commandant du camp de sûreté de
Schirmeck, sera condamné à mort à la Libération.
Mais n’effectuera, dans les faits,
qu’une dizaine d’années de prison. © La Nuée
Bleue
Quand je suis entré dans la baraque, il y avait bien une
vingtaine de prisonniers qui m’ont
entouré pour avoir des nouvelles de l’extérieur.
J’ai dit que je ne savais rien. Et puis,
j’entends une voix qui dit :”Lucien, c’est
toi ?”
C’était mon père !
On a parlé toute la nuit : il m’a dit que ceux de
Reichshoffen étaient là.
J’avais décidé de ne jamais rien avouer. Mais
alors, je savais ce que les Allemands
savaient déjà, et je pouvais avouer ce qu’ils
savaient.
Le lendemain, le commandant Karl Buck m’a fait venir
à la Kommandantur encadré par
les deux SS qui m’avaient amené. Il les a insultés
et les a menacés de les faire fusiller.
Et les deux SS au garde-à-vous, à chaque insulte et à
chaque menace, disaient :
”Yawohl, Herr Kommandant !” en claquant les
talons.
Schirmeck était un camp qui dépendait du Struthof. Il
se trouvait à La Broque, et il n’en
reste rien aujourd’hui. J’en ai vu beaucoup qui
partaient pour le Struthof.
Les gestapos de Schirmeck m’ont interrogé durement.
Ils étaient deux :
Peters et Koch. Un jour que Koch était sorti, Peters
m’a dit :
“Mentez pour sauver votre vie”.

LE
PROCES DE 1943 !

Au procès, en 1943, le procureur allemand a dit :
”Dans tous les camps d’Allemagne, on connait
Reichshoffen et le Rehthal.”

Lucien Fischer rapporte :
On était 27 accusés. Le procès a duré jusqu’au
22 Juillet 1944. C’était un samedi.
C’était le jour de l’attentat contre Hitler.
Au tribunal, ils étaient comme fous.
Ils discutaient, téléphonaient, ... mon avocat, un
alsacien qu’on m’avait donné parce que
je n’avais pas les moyens de m’en payer un,
m’a dit :
”Ils sont comme fous, ils ne m’écoutent même
pas !”.
J’ai alors cru que c’était fini pour nous !
Le juge a condamné Paul Rudloff à mort (peine commuée
en 8 ans de travaux forcés),
mon père et ma mère à 2 ans de travaux forcés et moi
à mort.
Mon avocat a fait commuer ma condamnation en 8 ans de
travaux forcés parce que je
n'avais pas 18 ans au moment des faits. Je suis resté en
cellule avec menottes et chaines.
Mon père et ma mère ont été en prison. J’ai
été envoyé à Ensisheim, près de Mulhouse,
puis à Ludwigsberg, à Ulm, à Flossenbourg près de la
Tchécoslovaquie : les Allemands
nous déplaçaient quand les Alliés avançaient.
J’ai fini par me retrouver à Bayreuth, en
octobre-novembre 1944, dans un commando qui
sortait les bombes non explosées. On sortait aussi les
morts qu’on trouvait sous les ruines
des maisons détruites par les bombardements.

EN
PRISON !

Témoignage de M. André STOLTZ :
Quelques mots pour vous faire connaître les raisons de
ces quelques lignes concernant la
famile Rudloff.
Mon père STOLTZ Emile, né en 1909, décédé en 1971,
ce dernier ancien prisonnier de guerre
et déporté politique ayant été
détenu à Schirmeck au camp du Struthof ma légué peu
avant sa
mort un dessin signé P. Rudloff
1943 réalisé selon ses dires au "charbon de
bois", moyen
utilisé en guise de crayon qui
devait faire défaut.
Pour descriptif, il s'agit d'un paysage d'automne avec un
avant plan représentant un ruisseau,
sous le dessin est porté l'inscription suivante :
In Mémoriam Parentium Meorum Filius Eorum Emilius STOLTZ
Schirmeck 1943.
(Emile Stoltz, pour la mémoire de ses
parents et leurs enfants)
STOLTZ Emile est né à Strasbourg le
12.09.1909, il est détenu depuis le16.12.1942
à Schirmeck et est sortie le 23.05.1944.
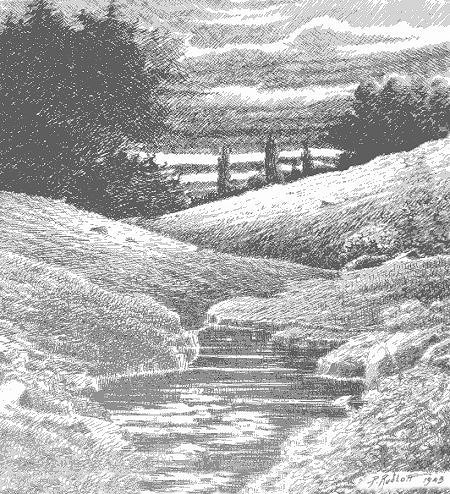
Monsieur Paul Rudloff a été gracié par les militaires
allemands, au Struthof il a continué à
exercer ses talents de peintre et de temps à autre un
officier allemand lui demandait
d'effectuer son portrait ou une autre peinture !
Paul Rudloff est interné à Schirmeck le 13 février
1943, il est libéré le 14 mars 1945 à
Bayreuth en Allemagne à 40km de la frontière Tchèque.
Dans la Chapelle de Wolfhartshoffen, Paul Rudloff a peint
la Jeanne d'Arc.

Détail de la peinture catholique (du XXe siècle) de
Paul Rudloff "Marie priant pour Bernadette
Soubirous et Jeanne d'Arc"
Durant la seconde guerre mondiale, ce
tableau a été décroché et mis à l'abri des
éventuels
collectionneurs allemands !
Des actes de résistance organisée, comme celles de la
filière de passage de prisonniers de
guerre de Reichshoffen est démantelée les 16, 22 et 24
février 1943.
Lors de l’arrestation de dix-huit de ses membres
faisant suite à des dénonciations.
Tous sont enfermés au Stalag de Schirmeck.

UN
GRAND SECRET, UNE GRANDE HUMILITE !

Suite du témoignage de Lucien Fischer :
… On n’a jamais su qui nous envoyait les
évadés. Aujourd’hui encore on l’ignore.
Mais nous ne savons pas non plus comment les évadés
sont passés après notre arrestation.
(C’était donc une organisation très
secrète, discrète avec des gens de confiance).

"On n'a jamais su qui nous envoyait les
évadés !"
Nous n’avions qu’une motivation : aider ceux
qui avaient besoin de nous.
Après la guerre, il n’y a pas eu de règlements de
compte dans notre région.
Il y avait bien des gens qui étaient pro-allemands mais
on savait qu’ils ne dénonceraient
personne.
On ne voulait pas être des héros, on voulait seulement
continuer à vivre …

UN
AUTRE PASSEUR !

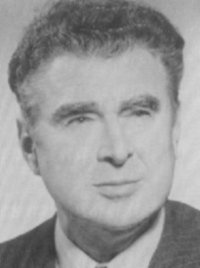
François Grussemeyer (Ancien député Maire
de Reichshoffen)
Incorporé au 5e régiment du Génie à Versailles, il
est fait prisonnier par les Allemands en
juin 1940. De retour chez lui, il se lance dans la
Résistance et rejoint la filière des passeurs
de Reichshoffen, qui faisait évader des prisonniers.
Arrêté par la Gestapo en février 1943, il est interné
au camp de Schirmeck le 18 février,
puis incorporé de force dans la Wehrmacht et envoyé en
Tchécoslovaquie, en Crimée et
en Pologne. Rapatrié du front de l'Est en juin 1945.
Extrait des DNA

"On ne saurait tracer un tableau fidèle de ce que
les Alsaciens ont fait non seulement en
Alsace mais encore dans les autres régions de
l’Allemagne.
De nombreux Alsaciens se trouvant de force éloignés de
leur pays natal ont travaillé à leur
compte personnel. Si certaines mesures ont surgi du
nombre et attiré particulièrement
l’attention publique, c’est grâce aux procès
retentissants et à leurs condamnations".
http://www.resistance-deportation.org/

UNE
AUTOROUTE DE L'EVASION !

Eric Le Normand président de
l'Association AERIA insiste sur le fait que la
résistance à
Reichshoffen s’est vraiment
illustrée par "les filières
d’évasions".
Elle est l’œuvre de 2
hommes, puis l’organisation s’est étoffée.
Paul Rudloff était peintre et
Alphonse Burckert était boulanger.
C’est l’association de ces
2 hommes qui a mis en place toute une organisation dans
le secteur
de Reichshoffen, et petit à petit
l'organisation s'en renforcée avec d’autres
personnes dans
d’autres villages dont
notamment Artzviller et le Rehthal.
Cette filière d’évasion a
vraiment fonctionnée d’une manière très
importante.
Nous savons qu’au Rehthal, il y
a eu 3 000 personnes qui sont passées, on imagine
qu’une
partie provenait de Reichshoffen.
Après le démantèlement de toute
la filière, du Rehthal jusqu’à Reichshoffen, le
procureur
allemand parlait de groupe
d’évasions, "d’autoroute de
l’évasion !"
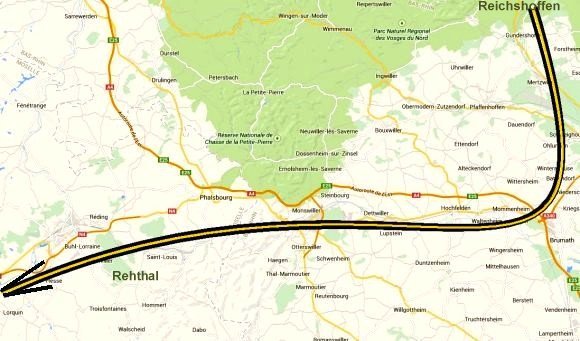
L'autoroute de la liberté !
Essentiellement des prisonniers de guerre qui
s’étaient évadés de Stalags (camp de
prisonniers soldats) ou d’Oflags (camp de
prisonniers officiers) en Allemagne.
Les prisonniers de guerre arrivaient
toujours au niveau des villes importantes le long du
Rhin,
et ensuite allaient vers des
villages comme Reichshoffen qui était des relais pour
ensuite
continuer vers la nouvelle
frontière (entre l'Alsace annexée et la France).
Au début, il y avait surtout des
prisonniers de guerre, dans les années 1940-1941, mais
par la
suite il y a eu une diversification
de tous ces individus qui ont voulu franchir la
frontière et à
ce moment-là on a eu des femmes,
des enfants, des familles, par exemple des familles
juives
qui ont voulu fuir l’Alsace.
Vous avez également des familles de
résistants qui ont voulu fuir l’Alsace, des
résistants
eux-mêmes, ceux qui ont été «
Grillés » !
C’était devenu des passages
plus difficiles et c’est ainsi qu’on a vu les
premières filières
d’évasions détruites par les
agents de la Gestapo.
Notons que les Alsaciens n’ont pas résisté comme
le reste de la France avec l’image qu’on a
de Jean moulin, du Général de
Gaulle, des maquis, des FFI, et autres.
En Alsace, il y a eu une résistance
spécifique, dont Reichshoffen est un excellent exemple,
des filières d’évasions il
n’y a avait pas partout en France.
En Alsace, vous aviez les filières
d'évasions et la résistance des Malgré-nous.
Si la frontière était marquée
entre l’Alsace et le reste de la France, elle
n’était pas marquée
entre l’Alsace et le Reich
Nazi. Les Alsaciens pouvaient aller dans le Reich,
justement pour
rapporter des renseignements mais
également pour rapporter des prisonniers de guerre
directement des camps. Nous avons
vraiment une résistance spécifique.
PROJET AERIA :
Le projet de réalisation du cédérom "La
Résistance des Alsaciens" devrait être finalisé
en
2016.
Les particuliers en possession d’informations ou
d’archives privées. Leur prêt, textes et
photos, sera essentiel pour enrichir les connaissances et
rendre plus intéressant l’espace
multimédia novateur.
AERIA CONTACT : laresistancedesalsaciens@gmail.com.
http://www.aeri-resistance.com/

GUIDER
VERS LA LIBERTE !


La Place des passeurs à Abreschviller
(inaugurée en 2011)
Lors de l'inauguration en 2011, de la place des Passeurs
à Abreschviller, dans son discours,
Michel Henry mentionne "en juin 1940, des milliers
de soldats prisonniers furent rassemblées
dans les camps provisoires à Sarrebourg, les évasions
commencèrent dès cette date".
En juillet 1940, la frontière de 1871 fut rétablie
séparant la Moselle de la France.
Des filières d’évasions se mirent en place à ce
moment-là.
Les évadés qui s’égaraient arrivèrent à
Abreschviller, où il n’y avait pas de filière (de
passeurs)
mais une nébuleuse bonne volonté. La population les
accueillait, les nourrissait, parfois les
habillait et "les guidait vers la liberté".
Leur sécurité l’exigeant, les passeurs ne
laissèrent
aucune archive, leur histoire ne peut être établie
qu’à partir de témoignage et des aveux fait
à la police allemande et aux tribunaux par ceux qui
furent arrêtés et condamnés.
Dans ce cas, ils minimisaient leur action. De nombreuses
personnes d’Abreschviller furent
arrêtées, condamnées, internées, et certains mourir
en déportation.
Les témoins de cette époque sont devenus rares. Aussi,
nous sommes très reconnaissant
à Monsieur Lucien Fischer qui fut l’un des
principaux passeurs de la filière du Rehthal qui a
mené des milliers d’évadés vers la France, il
réhausse cette inauguration par sa présence.
Ce souvenir de ces humbles héros s’estompe...
Le village d’Abreschwiller s’honore en plaçant
leur souvenir au centre de la cité à proximité
du futur groupe scolaire mettant ainsi à la portée de
nos enfants le souvenir de ceux qui
furent nos premiers résistants, les plus constants, les
plus désintéressés et les plus modestes.

LITTERATURE
ET PRESSE !

Lise POMMOIS - Fernand Philipps ..., "Tempête sur
les Vosges du Nord".
Chroniques de l'hiver 1944-45.
Edité par la Société d'histoire et d'archéologie du
Ried-Nord
(16, rue de la Gare, 67410 Drusenheim).
Description minutieuse de l'offensive allemande Nordwind
où les Allemands parvinrent
jusqu'à Wingen près de la Petite-Pierre.
En outre des renseignements utiles sur la filière des
passeurs de Reichshoffen-Rehthal près
de Plaine-de-Walsch. Avec de nombreuses photographies.
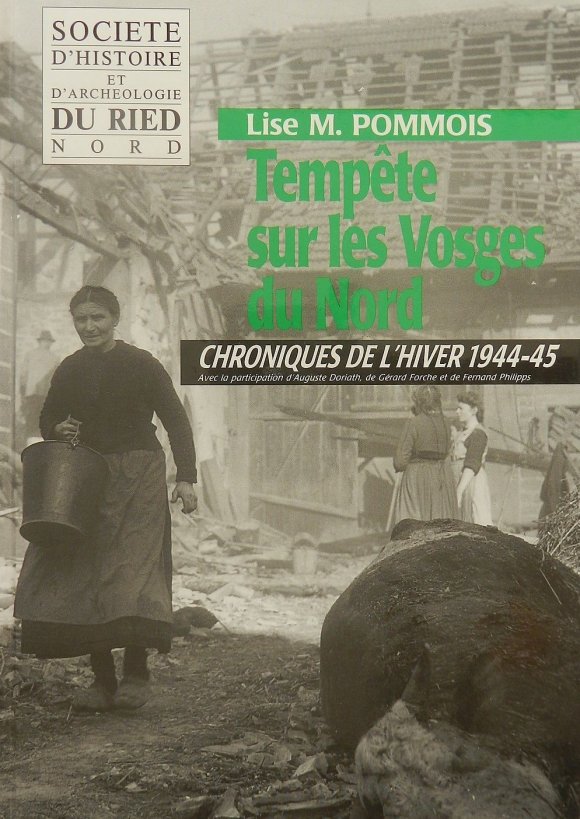

JOURNAL
"DNA" : UN NID DE FRANCAIS, A REICHSHOFFEN !

La plume adroite de la journaliste des DNA Geneviève
Lecointre retrace l'histoire des passeurs,
résistants de l'ombre :
Une Journée de la résistance aura désormais lieu
chaque 27 mai, selon une proposition de loi
votée en juillet par le Parlement. À Reichshoffen, une
discrète stèle de grès rose raconte
l'histoire des habitants qui ont risqué leur vie en
cachant des prisonniers durant la Seconde
Guerre mondiale.
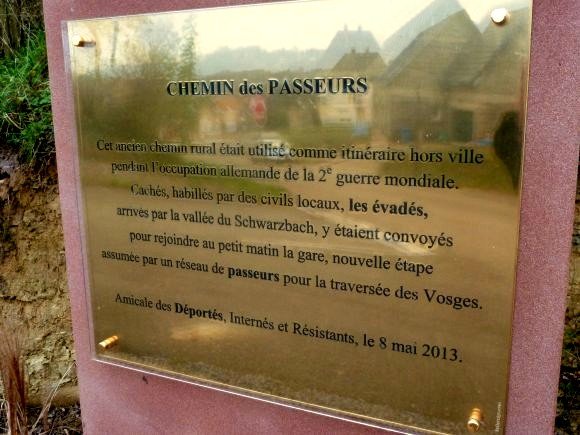
La stèle en mémoire des passeurs de
Reichshoffen.
Ils sont peut-être arrivés par là, sur ce chemin qui
descend de la vallée du Schwarzbach à
travers la forêt... Durant la Seconde Guerre mondiale,
des prisonniers français évadés
d'Allemagne ont trouvé refuge à Reichshoffen. Des
habitants les ont cachés au péril de leur vie,
avant de les aider à rejoindre la « France de
l'intérieur ».
La ville était occupée depuis le 19 juin 1940. «À
midi, trois soldats allemands très arrogants se
sont postés au carrefour de l'ancienne mairie. Le gros
de la troupe est arrivé ensuite à
bicyclette» se souvient Fernand Phillipps qui avait 15
ans à l'époque.
Dans cette bourgade connue pour être un Franzosennest
"un nid de français" cela était mal
vécu.
Dans la ville occupée, des prisonniers ont cependant
commencé à arriver seul ou à deux,
toujours la nuit. « Ils devaient passer par
Obersteinbach et se repérer grâce au clocher de
l'église haut de 72 mètres », suppose Fernand Philipps
qui a fait des recherches sur cette
période restée occulte.
Un mystérieux indicateur leur aurait fourni des adresses
sûres où ils pourraient se mettre à
l'abri, une fois la frontière passée...
Ils avaient entendu parler de planques «aménagées dans
le clocher de l'église et dans un autel
creux au fond de l'édifice. En le tirant du mur, ils
découvraient une alcôve pour une ou deux
personnes dans laquelle ils pouvaient se glisser et se
reposer en attendant qu'on vienne les
chercher».
Seul un petit noyau était dans la confidence. Car la
filière aujourd'hui dite des « passeurs »
s'était organisée.
À sa tête, l'artiste peintre local Paul Rudloff. «
Seul un petit noyau d'ouvriers, d'artisans,
d'employés et d'agriculteurs du coin était dans la
confidence. Le plus souvent, leur rôle se
limitait à accueillir les prisonniers et à les conduire
dans les fermes en périphérie de la ville »
parfois en les cachant quelque temps dans le petit
oratoire de la famille Singer au cimetière.
Si Fernand Philipps connaît si bien l'histoire, c'est
que son père Luc, tailleur de profession,
retouchait fréquemment les fripes dont on avait revêtu
les évadés. « S'ils se faisaient prendre
avec des manches trop longues ou des bas de pantalon trop
courts, les Allemands auraient
trouvé ça louche. S'ils présentaient bien, ils
pouvaient passer pour des gens de chez nous. »
Il ne fallait pas s'éterniser à Reichshoffen mais
gagner rapidement la gare, noeud ferroviaire
idéal pour quitter la zone frontière et s'enfoncer à
l'intérieur des terres, réputées plus sûres.
« De très jeunes filles de 17 ou 18 ans, dont il faut
reconnaître le courage, faut-il dire
l'inconscience, étaient mises dans le secret parce
qu'elles étaient moins suspectes que les
hommes », raconte Fernand Philipps. « Elles achetaient
le billet en choisissant un guichetier
de confiance. »
La ruse consistait à partir en direction de Strasbourg
plutôt que de la Moselle.
« Une seconde adolescente montait dans le train et
descendait à Haguenau pour acheter un
billet pour Sarrebourg ou ailleurs. Elle le glissait dans
une revue allemande qu'elle posait sur
une charrette à bagages. Le prisonnier le récupérait
et poursuivait sa route vers l'autre côté
des Vosges où il était pris en charge par d'autres
passeurs. »
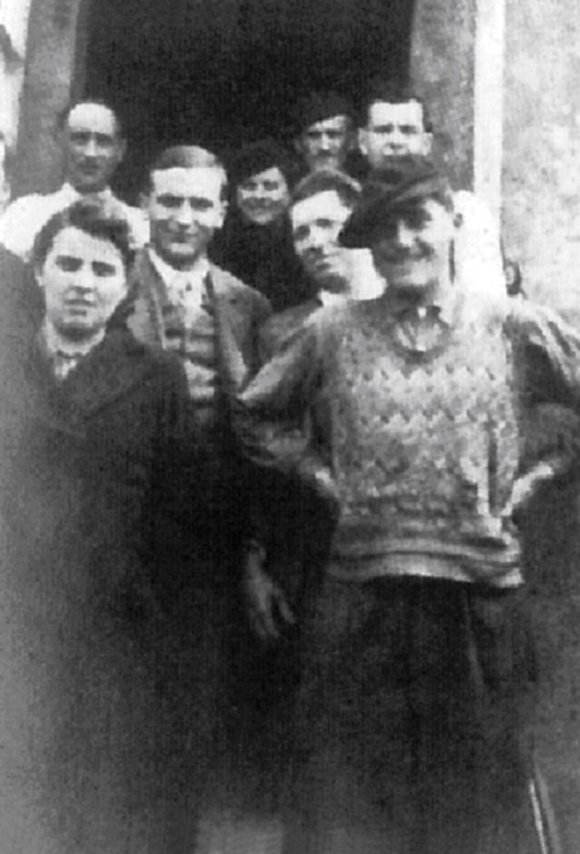
Devant à partir de la gauche : Lucie
Rickling et Lucien Fischer
Derrière : ..., ..., Jeanne Koessler, ..., ..., ...
Piégés par la Gestapo :
Combien de personnes ont-elles été ainsi sauvées ? «
Difficile à dire, reconnaît Fernand
Philipps.
Peut-être une vingtaine... » avant que la Gestapo ne se
doute de quelque chose.
« Les nazis ont envoyé de Nancy un nommé Chavannes. Il
s'est installé avec une jolie femme
à l'auberge de l'Ange d'or où Paul Rudloff prenait
régulièrement son café.
Heureux de rencontrer cet homme francophone et bien mis,
le chef de la filière s'est peut-être
montré trop confiant... », relate Fernand Phillipps.
Les 13 et 14 mars 1942, une trentaine de passeurs
étaient arrêtés et conduits au camp de
Schirmeck. « Heureusement, mon père n'en faisait pas
partie », précise-t-il.
Considéré comme « l'organisateur de ce trafic », Paul
Rudloff a été condamné à mort avant
de voir sa peine commuée en dix années de travaux
forcés. Après la Libération, il est revenu
avec tous les autres dans la cité des Cuirassiers « et
personne n'a plus voulu en parler ».

En 1941, tout était en friche et
inhabité ! (Chemin des Passeurs)
Des lettres au fond des tiroirs :
Le temps a passé. Tous les passeurs sont aujourd'hui
décédés et seules des lettres retrouvées
par des enfants, des petits-enfants au fond des tiroirs
témoignent du courage de ces résistants.
Fernand Philipps déplie un papier jauni, s'éclaircit la
voix et lit : « Lille, le 19 juin 1956.
Vous m'avez recueilli, c'était en mars 1942, je pense
souvent à tous ces chers amis de
Reichshoffen, Rudloff, le brave coiffeur, l'admirable
tailleur et tous les autres. »
Une missive reconnaissante signée de la main d'un ancien
prisonnier.
De son secrétaire, il sort aussi une photo, hésite à
la montrer. Un homme décharné est allongé
sur un lit : « Il s'appelait Paul Walz. Instituteur à
Niederbronn-les-Bains puis à Reichshoffen,
il avait été envoyé en Allemagne pour être initié
aux méthodes nazies.
Je pense que c'est lui qui a donné aux évadés des
adresses à Reichshoffen parce qu'il a été
condamné à mort et envoyé dans les plus rudes prisons
d'Allemagne avant d'être libéré par
les Américains. » Soigné en Suisse durant plusieurs
mois, l'enseignant est revenu en Alsace
du Nord où il s'est éteint à la fin des années 1990.
Au mois de mai 2013, l'Amicale des déportés, internés
et résistants inaugurait une stèle à
l'angle de la rue des Cigognes et du chemin des Passeurs.
Pour que les passants se souviennent que « cet ancien
chemin rural était utilisé comme
itinéraire pendant l'occupation allemande de la Seconde
Guerre mondiale » et que les évadés
ont été « cachés, habillés par des civils locaux ».
Une petite plaque de cuivre sur un morceau de grès rose
au bas de la vallée du Schwarzbach,
aussi forte et discrète que l'action de ces résistants.

Le chemin des passeurs à Reichshoffen
Liens configurés pour Internet Explorer :
Témoignage d'un malgré-nous
Autre témoignage

Source des informations : Lucien
Fischer, DNA, Républicain Lorrain, SHARE, AERIA
Lien FILIERE
DE REICHSHOFFEN
|


|

